Chauffour, Julien (2023). Érasme et l'ars male dicendi : archéologie et poétique de l'invective d'Ammien Marcellin à Ulrich von Hutten. Thèse. Rimouski, Université du Québec à Rimouski, Département de lettres et humanités, 402 p.
|
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Résumé
RÉSUMÉ : L’invective du XVIe siècle présente une grande disparité de formes littéraires et de postures éthiques : lettre ou discours, poème satirique ou pamphlet, vers ou prose en soutien au pouvoir royal, mode de résolution d’une querelle entre humanistes. Érasme s’inscrit dans cette variété comme l’un des plus importants maîtres de l’ars male dicendi, parce qu’il pratique la polémique toute sa vie, mais aussi parce qu’il réfléchit sur la violence verbale. Mais la seule définition érasmienne ne suffit pas à expliquer la polysémie et l’ambivalence morale de l’invective. Il faut se tourner vers le passé : grâce à une enquête philologique retraçant les apparitions des termes invectiva et invectio dans l’histoire de la rhétorique, il est permis de replacer l’invective érasmienne dans le paysage rhétorique de son siècle. Cette enquête montre que l’invective est un genre prestigieux, qui noue ensemble la grandiloquence de la catilinaire cicéronienne et le sublime augustinien de la prédication. Au XIIe siècle, ce prestige de l’invective culmine, dans sa forme épistolaire, au sein des grandes collections de lettres de chancellerie, tout en amorçant un déclin, car elle commence à désigner aussi des poèmes satiriques, perçus par les clercs érudits comme injurieux ou obscènes. Ainsi, l’archéologie de l’invective permet de dégager une poétique dont Érasme apparaît comme l’accomplissement et l’un des derniers représentants, avec Ulrich von Hutten et Hélisenne de Crenne : la prestigieuse lettre oratoire, qui fait de l’humaniste un orateur, sur le modèle de Pétrarque. De plus, la lettre invective érasmienne est nuancée, car la mémoire polémique et l’émulation des modèles lui procurent une large palette de figures, de stratégies et d’arguments, de la stratégie que Jérôme développe contre Rufin aux arguments philologiques de Valla et Politien. En même temps, l’ambivalence apparue au XIIe siècle persiste et s’accentue : l’invective désigne de plus en plus la satire et l’injure, si bien que le XVIe siècle voit naître l’idée de séparation entre la chose et la personne dans l’invective, concept absent de la culture de la vitupération que véhiculent les rhétoriques des Anciens. En effet, jusqu’à Érasme et l’effort de restitutio de la rhétorique antique par les humanistes, attaquer la personne est non seulement autorisé, mais aussi encouragé. Au contraire, après le premier tiers du XVIe siècle, la séparation entre la personne et la chose consacre la caducité de l’invective prestigieuse : dès lors, l’invective contre la chose conservera pour quelque temps encore le rôle noble de la résipiscence, confié auparavant par Augustin à l’invectio, tandis que la violence verbale du sublime cicéronien n’est plus comprise et devient une injure. Par conséquent, il se produit au XVIe siècle un changement de paradigme éthique et esthétique qui transforme les discours polémiques et les éloigne de la culture de la vitupération. À ce titre, la différence entre les deux définitions de l’invective contenues dans le De conscribendis epistolis d’Érasme et dans celui de Juan Luis Vives est emblématique. Ainsi, un discours de Cicéron prononcé contre un tyran et une attaque verbale injurieuse de quelques mots en viennent à être tous les deux désignés par le terme invective. -- Mot(s) clé(s) en français : rhétorique, invective, polémique, éthique, Érasme. --
ABSTRACT : The invective of the sixteenth century presents a great disparity of literary forms and ethical postures: letter or speech, satirical poem or pamphlet, verse or prose in support of royal power, mode of resolution of a quarrel between humanists. Erasmus is part of this variety as one of the most important masters of the ars male dicendi, because he practiced polemics all his life, but also because he reflected on verbal violence. But the Erasmian definition alone is not enough to explain the polysemy and moral ambivalence of invective. We must turn to the past: thanks to a philological investigation tracing the appearances of the terms invectiva and invectio in the history of rhetoric, it is possible to clarify the place of Erasmian invective in the rhetorical landscape of his century. This investigation shows that invective is a prestigious genre, which ties together the bombast of the Catilinarian speech and the Augustinian sublime of preaching. In the twelfth century, this prestige of invective culminated, in its epistolary form, in collections of chanceries’ letters, but also decreased, because it began as well to designate satirical poems, perceived by learned clerics as offensive or obscene. Thus, the archaeology of invective makes it possible to identify a poetics of which Erasmus appears as the accomplishment and one of the last representatives, with Ulrich von Hutten and Hélisenne de Crenne: the prestigious oratory letter, which makes the humanist an orator, on the model of Petrarch. But the Erasmian invective letter is nuanced, because the polemical memory and the emulation of the models gives him a wide range of figures, strategy and arguments, from the strategy that Jerome develops against Rufin to the philological arguments of Valla and Politien. At the same time, the ambivalence that appeared in the twelfth century persists and spreads: invective increasingly refers to satire and insult, so that the sixteenth century sees the birth of the idea of separation between the thing and the person, concept absent from the culture of vituperation conveyed by the rhetoric of the ancients. Indeed, until Erasmus and the humanist effort of restitutio of the ancient rhetoric, attacking the person was not only authorized, but also encouraged. On the contrary, after the first third of the sixteenth century, the separation between the person and the thing makes the obsolescence of the prestigious invective: from then on, the invective against the thing will retain for some time the noble role of converting hearts, previously entrusted by Augustine to the invectio, while the verbal violence of the Ciceronian sublime is no longer understood and becomes an insult. As a result, there was an ethical and aesthetic paradigm shift in the sixteenth century that transformed polemical discourses and distanced them from the culture of vituperation. As such, the difference between the two definitions of invective contained in Erasmus’s De conscribendis epistolis and Juan Luis Vives’s is emblematic. Thus, a speech by Cicero against a tyrant and an insulting verbal attack of a few words both come to be referred to as invective. -- Mot(s) clé(s) en anglais : rethoric, invective, polemic, ethic, Erasmus.
| Type de document : | Thèse ou mémoire de l'UQAR (Thèse) |
|---|---|
| Directeur(trice) de mémoire/thèse : | La Charité, Claude |
| Co-directeur(s) ou co-directrice(s) de mémoire/thèse : | Bernier, Marc André |
| Information complémentaire : | Thèse présentée dans le cadre du programme de doctorat en lettres en vue de l'obtention du grade de Philosophiae doctor. |
| Mots-clés : | Érasme; Rhétorique; Morale; Invectives dans la littérature; Polémique dans la littérature. |
| Départements et unités départementales : | Département de lettres et humanités > Lettres |
| Date de dépôt : | 11 nov. 2025 16:36 |
| Dernière modification : | 11 nov. 2025 16:36 |
| URI : | https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/3348 |
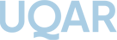
 Service de la bibliothèque
Service de la bibliothèque
 Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement  Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement